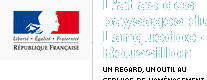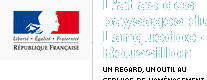|
> Les fondements des
paysages du Gard
II/ Fondements culturels
Aperçu sur les représentations
des paysages du Gard
Le Pont du Gard
La sensibilité aux vieilles pierres a longtemps cristallisé
l’attention des voyageurs, qui témoignaient d’Aigues-Mortes,
de Nîmes et ses monuments gallo-romains, et surtout du Pont du Gard.
Les représentations de l’aqueduc Romain sont extrêmement
nombreuses, aussi bien littéraires que picturales. La lecture des témoignages,
l’examen des peintures et des gravures, révèle au moins
deux faits essentiels en matière de paysage pour le Pont du Gard :
1) le Pont du Gard prend d’autant plus de valeur
aux yeux des voyageurs qu’il s’inscrit dans un pur cadre de nature,
sans autre trace de bâti :
c’est ce qu’exprime clairement Jean-Jacques
Rousseau, dans les Confessions, en 1782 :
« L’art de ce simple et noble ouvrage me
frappa d’autant plus qu’il est au milieu d’un désert
où le silence et la solitude rendent l’objet plus frappant et
l’admiration plus vive, car ce prétendu pont n’était
qu’un aqueduc ».
Dans ses Mémoires d’un touriste, en 1837, Stendhal
montre également à quel point l’ouvrage est valorisé
par son cadre naturel :
« Par bonheur pour le plaisir du voyageur né
pour les arts, de quelque côté que sa vue s’étende,
elle ne rencontre aucune trace d’habitation, aucune apparence de culture
: le thym, la lavande sauvage, le genévrier, seules productions de
ce désert, exhalent leurs parfums solitaires sous un ciel d’une
sérénité éblouissante. L’âme est
laissée tout entière à elle-même, et l’attention
est ramenée forcément à cet ouvrage du peuple-roi qu’on
a sous les yeux ».
Même Mérimée, plus attentif à
l’architecture qu’au paysage, le précise dans ses « Notes
d’un voyage dans le Midi de la France », en 1835 :
« Le site sauvage, la solitude complète
du lieu, le bruit du torrent ajoutaient une poésie sublime à
l’architecture imposante qui s’offrait à mes yeux ».
2) la découverte du Pont du Gard dans ce cadre de nature est soudaine
et surprenante, participant de cette impression grandiose qui frappe les voyageurs
:
Alexandre Dumas témoigne de la mise en scène
de cet « arc en ciel de pierres » :
« Tout à coup nous aperçûmes
au-dessus du feuillage sombre des chênes verts et des oliviers, se
détachant sur un ciel bleu, deux ou trois arches, à teinte
chaude et jaunâtre : c’était la tête du géant
romain. Nous continuâmes d’avancer, et au premier coude que fit
la montagne, nous l’embrassâmes dans tout son ensemble, à
cent pas à peu près de nous ».
Alexandre Dumas,
Midi de la France, 1837-1841
Henry James, témoigne également de la valeur
de cette découverte soudaine :
« J’accordai toute mon attention à cette
grandiose construction. On s’en approche de très près
avant de la voir : le ravin qu’il enjambe s’ouvre brusquement
et découvre le spectacle, qui devient alors d’une extrême
beauté ».
Henry James,
1877, Voyage en France, Paris, R. Laffont 1987
En ce sens, le Pont du Gard est beaucoup plus qu’un monument. C’est
un véritable paysage, associant de façon exceptionnelle l’objet
à son contexte, le tout dans une mise en scène dont l’attente,
l’approche et la brusque découverte participent.

|