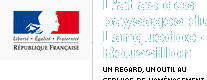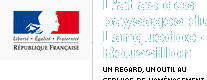> Paysages
de la Lozère : les enjeux majeurs
Les enjeux majeurs pour un aménagement qualitatif du territoire
- 1. La gestion par l’élevage des
grands espaces ouverts
- 2. L’inventaire, la protection,
la gestion … et l’invention du « petit » patrimoine
- 3. La diversification de la forêt
- 4. La qualité des lieux
de vie, de circulation et d’accueil
- 5. La maîtrise paysagère
de l’urbanisation
- 6. La préservation des paysages –
sites
|
> Paysages de la Lozère : les enjeux majeurs
Les 6 enjeux majeurs pour un aménagement qualitatif du territoire
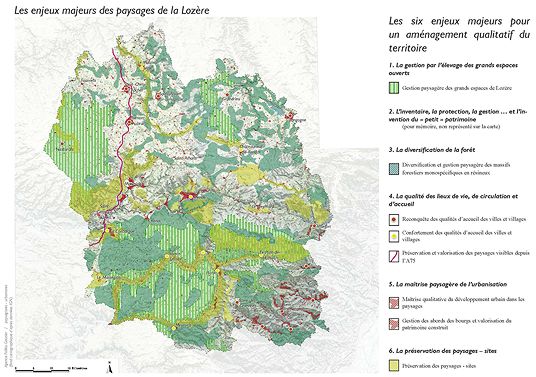
2. L'inventaire, la protection, la gestion . et l'invention
du "petit" patrimoine
Le "sel" du paysage
 |
Petit pont sur les flancs du Mont Lozère (ferme de la Vialasse) |
 |
Maison caussenarde à Sauveterre |
 |
Ronc, ou ranc, en Margeride |
 |
Boule de granite sur les pentes du Mont Lozère |
 |
Petit mur de pierres sèches vers le Bleymard |
 |
Bocage d'arbres et de murs de pierres sur le plateau de la
Garde-Guérin |
 |
Chemin dans l'Aubrac |
 |
Trame bocagère sur le rebord ouest du causse de Sauveterre
(vers le Tensonnieu) |
Le petit patrimoine rassemble tous les éléments
naturels ou construits qui concourent à la personnalité
d'un paysage :
- le petit patrimoine bâti : ferme, cazelle, buron, mazuc, jasse,
mais aussi menhir, dolmen, croix, calvaire, mur, muret, faïsse, bancel,
béal, lavogne, .
- le petit patrimoine végétal : arbres isolé, haie,
ensemble bocager, arbres d'alignement, .
- les chemins
- les chaos rocheux, ronc, tor, clapas, .
- .
Il s'agit souvent d'éléments modestes dans
le paysage, mais leur importance est pourtant capitale. C'est l'accumulation
de ces éléments particuliers qui font le charme et le caractère
d'un paysage. Pour oser une image culinaire, le petit patrimoine
est le sel du paysage, ce qui rehausse le goût et lui donne de la
saveur. La Lozère en est encore bien pourvue et la valeur de ces
éléments se mesure au grand nombre de cartes postales qui
en font un sujet de prédilection.
Un patrimoine menacé
 |
Bâtiments d'élevage récents sur le causse
Méjean, près de l'Aven Armand |
Le petit patrimoine tend imperceptiblement à disparaître.
Plusieurs phénomènes se conjuguent :
- la modernisation des techniques agricoles, le remembrement, tendent
encore aujourd'hui à simplifier l'espace de production
en supprimant les obstacles : disparition de haies, de chemins, de murs,
dans les vallées, mais aussi en Aubrac, en Margeride ;
- la standardisation des modes de construction conduit à ignorer
les particularités du site faites d'arbres, de terrasses,
de murs, de pente, et à en faire table rase ;
- l'abandon des espaces ouverts conduit à leur reconquête
par la forêt, qui fait disparaître progressivement le dessin
du paysage : cas des terrasses et des murs qui sculptaient les pentes
Cévenoles.
Par ailleurs les éléments nouveaux qui apparaissent dans
le paysage ne sont pas construits pour constituer le patrimoine de demain
: cas de certains bâtiments agricoles récents, standardisés
et donc banals.
Une identification nécessaire
 |
Hêtre isolé sur la can de l'Hospitalet : un «
monument » naturel remarquable, qui n'existe pourtant
nulle part, ni dans les cartes ni dans les documents d'urbanisme,
d'aménagement, ou de protections. |
Alors que le patrimoine naturel des espèces floristiques et faunistiques
fait l'objet d'inventaires précis, qui se traduisent
par des ZNIEFF, voire par des cartographies à l'échelle
de la parcelle dans le cas de Natura 2000, le petit patrimoine de paysage
est totalement ignoré car non apparent dans les documents d'aménagement.
Les cartes laissent en blanc des espaces pourtant riches de nombreux éléments
qui construisent le paysage : pas de représentation des terrasses,
des murs, des arbres isolés, des haies, etc sur les plans d'urbanisme,
sur les cadastres, sur les cartes IGN. La reconnaissance de ce petit patrimoine
passe par son inventaire et sa représentation : repérage
cartographique en premier lieu, notamment dans les documents d'urbanisme
communaux (PLU et cartes communales), mais aussi repérage photographique,
et diagnostic de son état. Cette identification est la première
mesure de reconnaissance du petit patrimoine. Il peut alors être
pris en compte pour nourrir les projets agricoles (remembrements, travaux
agricoles, .), les projet d'urbanisme (documents d'urbanisme,
projets d'urbanisation de logements, d'activités, .),
les projets d'implantations d'équipements, les projets
d'infrastructures.

|