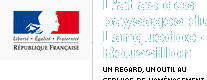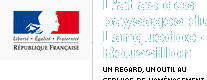|
|
|
> l'Herault
> Les garrigues
> 17. Les garrigues d'Aumelas et la montagne de la Moure
> Valeurs paysagères clefs
|
17. Les garrigues d'Aumelas et la montagne de la Moure |
Valeurs paysagères clefs |
Une montagne aplanie en causse et couverte de garrigues |
|
|
|
|
Les montagnes de la Moure et d'Aumelas sont formées du socle de calcaires jurassiques que l'on retrouve plus au nord dans le massif du Pic Saint-Loup, dans les causses qui cernent la Buèges, et dans les grands causses comme celui du Larzac. Au sud, la montagne de la Gardiole et le petit Mont Saint-Clair en sont les ultimes représentants méridionaux. Déposés sur de très grandes épaisseurs par les mers du Secondaire, ils offrent des surfaces assez aplanies, qui prennent même le visage d'un causse dans les hauteurs. On parle d'ailleurs du " causse " d'Aumelas. Des piochs ou puechs animent néanmoins le socle et, depuis les plaines adjacentes, les " montagnes " présentent leur silhouette aux formes rondes et pleines. Très filtrants, les calcaires sont incapables de retenir l'eau. Aussi la végétation est-elle celle d'une garrigue souvent appauvrie à base chênes kermès, offrant un paysage âpre et sec. Elle déroule de vastes surfaces pâles des pelouses à asphodèles, euphorbes et brachypodes, parfumées des touffes de thym et piquées de genévriers épars.
Des ruines de bergeries, d'enclos, de baraques, de murets, de capitelles, témoignent encore çà et là de l'activité passée de l'élevage. A ces traces s'ajoutent des sites naturels méconnus et insoupçonnables, comme les gorges que dessinent les méandres obstinés du ruisseau du Coulazou, qui traverse entièrement le massif avant de déboucher dans la plaine de Fabrègues en traversant Cournonterral.
La " montagne " forme ainsi aujourd'hui un espace d'évasion, offrant d'appréciables étendues désertes et ouvertes, aux portes de l'agglomération montpelliéraine et du littoral languedocien.
|
|
|
Des sites de grande qualité sur les marges, où se concentrent les rares cultures en vignes |
|
|
|
|
C'est surtout sur ses marges est et ouest que le massif prend des aspects pittoresques, lorsque le socle calcaire se faille en combes, dessine des pierriers grisâtres ou des falaises blanches, laisse sourdre des fontaines ou s'infléchit en dolines pour laisser d'étroites bandes de terres rouges de terra rossa cultivables : c'est d'ailleurs dans ces marges que l'habitat se rencontre principalement, sous forme de mas successifs.
Au nord, le piémont du grand massif boisé de Viols-le-Fort/Pic Saint-Loup est favorable à la culture de la vigne, qui se mêle à des lambeaux de garrigues et de pelouses sèches, et à l'urbanisation de Combaillaux, Vailhauquès, Montarnaud et Saint-Paul-et-Valmalle.
A l'est, près de Murviel-lès-Montpellier, se développe la vigne classée AOC de Saint-Georges-d'Orques.
|
|
|
Seulement cinq villages, concentrés au nord-est |
|
|
|
|
Seuls cinq villages se développent dans le secteur.
Combaillaux, Vailhauquès, Montarnaud et Saint-Paul-et-Valmalle s'appuient tous les quatre sur les contreforts de l'immense massif boisé de Viols-le-Fort qui s'allonge vers le nord jusqu'au Pic Saint-Loup.
Murviel-lès-Montpellier occupe le site romain d'Altimurium sur le flanc oriental de la montagne, ouvrant des vues sur Montpellier dont les immeubles collectifs se profilent loin à l'horizon.
|
|
|
Une pression lisible de l'urbanisation autour de l'A750 et dans les villages |
|
|
|
|
L'A750, branche autoroutière reliant Montpellier à l'A75, traverse le nord du secteur. Elle offre trois échangeurs (Juvignac, Montarnaud, Saint-Paul-et-Valmalle) qui, ajoutés à la proximité immédiate de l'agglomération Montpelliéraine, font porter une forte pression de développement.
Celle-ci se lit sur les marges de l'A750, dégradées par quelques implantations de zones d'activités mal maîtrisées, difficiles à " intégrer " dans le paysage sec et râpeux des garrigues. Le passage des lignes électriques contribue à fragiliser le paysage (garrigue de Tamareau).
Par ailleurs les villages se sont tous largement étalés, consommant l'espace de la plaine comme celui du piémont sur lequel ils s'appuient, sans parti clair en matière de paysage et d'urbanisme.
|
|
|
|
|