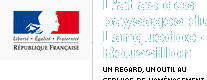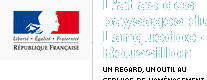|
|
|
> l'Herault
> Les garrigues
> 15. L'agglomération de Montpellier
> Valeurs paysagères clefs
|
15. L'agglomération de Montpellier |
Valeurs paysagères clefs |
Une rencontre de six grands paysages autour du Lez |
|
|
|
|
Avec la dilatation de la ville à l'agglomération, l'urbanisation du grand Montpellier touche aujourd'hui des territoires fort divers. Il y a de véritables " quartiers " de paysages qui se dessinent, non par des choix urbains et architecturaux différenciés (les lotissements ou zones d'activités de l'est ressemblent à ceux de l'ouest), mais par la simple force de la géographie.
Six territoires bien différents se distinguent :
- Au nord-est, avec Jacou, le Crès, Vendargues, Castries et Teyran : les collines et garrigues qui vont courir plus loin jusqu'au Vidourle (UP n° 14) ;
- Au nord avec Clapiers, Montferrier-sur-Lez, Assas, Prades-le-Lez, Saint-Vincent-e-Barbeyrargues, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc : les reliefs plus puissants développés autour du Lez, qui vont s'accentuant en remontant vers le Pic Saint-Loup (UP n° 16) ;
- Au nord-ouest autour de Grabels et d'une partie de Juvignac : les garrigues qui vont aller se développant sur le causse d'Aumelas (UP n° 17) ;
- A l'ouest, avec Juvignac au-delà de la Mosson : la plaine viticole de Fabrègues (UP n° 6), qui s'allonge plus loin entre les garrigues d'Aumelas et la montagne de la Gardiole ;
- Au sud-ouest avec Saint-Jean-de-Védas : les derniers lambeaux de collines viticoles, avant qu'elles ne deviennent garrigues (montagne de la Gardiole, UP n° 2) ou plaine (plaine de Fabrègues, UP n° 6) ;
- Au sud enfin, avec Lattes, Boirargues, Pérols : la plaine littorale qui court de Lattes à Lunel (UP n° 5) et qui sépare les garrigues du littoral.
|
|
|
Collines, vallons, coteaux, vignes et parcs : une imbrication forte de l'agglomération et des espaces de nature, dans des contrastes parfois saisissants |
|
|
|
|
Si le cour urbain de Montpellier compte relativement peu de grands espaces non bâtis, la croissance de l'agglomération oblige à composer avec des données naturelles fortes : plaines inondables autour du Lez, et au sud de l'A9 (18 % du territoire de l'agglomération, ZNIEFF comprises), reliefs marqués couronnés de boisements, notamment au nord.
Les données économiques peuvent jouer aussi, notamment les AOC du vin (14 % du territoire de l'agglomération), qui expliquent la faible urbanisation au-delà de Pompignane à l'est.
Enfin les données patrimoniales et culturelles favorisent l'existence de jardins et de parcs aujourd'hui au cour du développement de l'agglomération : cas notamment du Jardin des plantes et de tous les grands domaines qui ont fleuri dans la campagne Montpelliéraine à partir du XVIIIe siècle : la Piscine, Alco, O, la Mosson, château Bon, le Terral, Rieu-Coulon Haut, Mas Nouguier, Massane, Lavérune, Flaugergues, la Mogère, etc.
En terme d'usages, l'ouverture progressive de ces espaces de nature au public, leur protection et leur gestion, sont de puissants facteurs de qualité de vie. En terme d'image, les contrastes nets qui se dessinent parfois entre ville et nature peuvent être valorisants.
C'est le cas par exemple de la vallée de la Mosson : le coteau raide que dessine la rivière-fleuve sur sa rive gauche stoppe actuellement nettement l'agglomération dans sa marche vers l'ouest, composant des paysages parfois spectaculaires de contraste ; au nord-ouest, les immeubles collectifs de la Paillade, des Hauts de Mossane et du quartier de la Mosson surgissent brutalement en haut du coteau, composant des horizons urbains étonnants depuis les bourgs de Juvignac et de Grabels, implantés en contrebas de l'autre côté de la rivière ; des vues largement dominantes s'ouvrent depuis ces quartiers urbains limitrophes de Montpellier sur les espaces de nature de la vallée de la Mosson, de la plaine de Fabrègues (Juvignac, Lavérune) et des garrigues de Font-Caude, dans une situation de contraste ville-nature rare et originale.
|
|
|
Un paysage des infrastructures dégradé |
|
|
|
|
Avec la RN 113 et l'autoroute A9 (mais aussi la RN 112, la RD 5), l'agglomération a connu développement linéaire est - ouest qui atteint aujourd'hui Castries, Baillargues et Saint-Brès à l'est, et la vallée de la Mosson au-delà de Saint-Jean-de-Védas à l'ouest. Marqué par les zones d'activités, complexifié par les nouds d'échanges des grandes infrastructures, accompagné par des lignes à haute tension, l'ensemble établit une rupture entre la ville au nord et la plaine littorale au sud. Le projet de ligne TGV pourrait contribuer au phénomène, tout comme celui du doublement de l'A9. Ce problème de dégradation du paysage des infrastructures se retrouve sur les grandes voies structurantes de l'ensemble de l'agglomération, mais aussi autour des voies d'entrées de villages et quartiers.
|
|
|
Une fragilisation des relations ville/nature par surconsommation parfois anarchique des espaces |
|
|
|
|
La pression très forte de l'urbanisation conduit à une fragilisation des espaces de nature pourtant précieux pour les usages agréables d'une agglomération contemporaine.
Les phénomènes les plus préoccupants sont :
- la consommation des plaines agricoles ou viticoles, où qu'elles soient, l'urbanisation ayant tendance à y " descendre " par commodité de construction, freinée seulement par l'inondabilité des terrains ; au cours des dernières années, 70% des espaces urbanisés étaient agricoles ;
- le mitage des collines boisées du nord, sans parti clair d'aménagement urbain et paysager ;
- la disparition d'espaces de respiration entre les noyaux urbains, notamment par l'urbanisation linéaire autour des voies de circulation, qui garantissent pourtant l'identification et la personnalité de chaque noyau.
|
|
|
Une pauvreté des espaces publics dans les nouveaux quartiers de lotissements |
|
|
|
|
Alors que les efforts qualitatifs se lisent dans les choix urbains et architecturaux de Montpellier, ses environs s'urbanisent encore sous forme de lotissements sans âme faute de conception d'espaces publics.
|
|
|
Une relation encore ambiguë au littoral -voir aussi UP 1 et UP 5- |
|
|
Bien qu'ayant toujours bénéficié de liaisons privilégiées avec le littoral, Montpellier est bien une ville " terrienne ", dans les collines et garrigues qui l'environnent, à distance du trait de côte dont elle est séparée par les plaines et les lagunes. L'engouement pour le bord de mer, l'aménagement de la côte Languedocienne, l'urbanisation des stations balnéaires de Palavas et de Carnon, tirent irrésistiblement l'urbanisation vers la Méditerranée. Pourtant le couloir d'infrastructures de l'A9, de la RN 113, des lignes à haute tension, peut-être un jour du TGV et du doublement de l'autoroute, introduit une césure dont on voit mal une " digestion " urbaine avant un long terme. C'est moins une continuité urbaine qui semble à constituer entre Montpellier et la mer qu'une véritable attention à l'espace entre les deux : les plaines et lagunes intermédiaires ne sont pas qu'un vide à conquérir, mais peuvent devenir un véritable support au développement d'un nouveau " quartier " à l'échelle de l'agglomération, tourné sur les zones humides des lagunes. Entre la ville des collines (Montpellier) et la ville du lido (Palavas-Carnon), la ville lagunaire reste à inventer, associant Lattes, Pérols, Carnon et Palavas autour de l'étang du Méjean et de ses plaines.
|
|
|
|
|