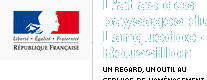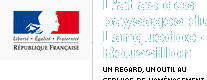|
|
|
> La Lozère
> La Margeride
> 8. La Montagne de la Margeride
> Valeurs paysagères clefs
|
8. La Montagne de la Margeride |
Valeurs paysagères clefs |
Une limite assez nette avec le plateau margeridien, notamment à l'ouest |
|
|
|
|
La Montagne de la Margeride domine de 300 à 400 m le plateau margeridien. Ses limites avec ce dernier sont relativement franches, liées aux anciennes failles le long desquelles s'est soulevée la Montagne. De l'extérieur, elle se présente ainsi comme un dos arrondi, assez aplani sur le dessus et assombri par la présence de la forêt et des landes.
|
|
|
Des reliefs plus amples que sur le plateau |
|
|
Les reliefs arrondis sont amples, abritant dans leurs plis des cuvettes creusées par les rivières naissantes qui s'échappent en couloirs plus ou moins étroits vers le plateau.
Des puechs, des trucs et des rocs se succèdent ainsi, les plus hauts étant au sud : Signal de Randon et Truc de Fortunio (1 552 m), ce dernier marqué par la tour de télécommunication et sa haute antenne visible de fort loin, qui sert de repère dans le grand paysage.
|
|
|
Des vues immenses sur le plateau de la Margeride, et, au-delà, vers l'Aubrac à l'ouest et les monts du Velay et du Vivarais à l'est |
|
|
|
|
Les hauteurs de la Montagne ouvrent des vues immenses sur la mosaïque du plateau de la Margeride et, plus loin, sur les horizons lointains, jusqu'aux monts du Vivarais à l'est.
|
|
|
Rancs, tors et patrimoine construit : le granite, omniprésent dans le paysage |
|
|
|
|
Erodée depuis des millions d'années, la Montagne laisse par endroits à nu son socle granitique, qui perce les prairies et couronne les sommets en gros blocs arrondis. Isolés par l'érosion, les blocs forment des tors tandis qu'amassés en groupes, ils composent des rancs, en général sur de petits sommets.
Aux formes naturelles s'ajoutent les constructions utilisant le granite : murets, piquets de clôtures, petit patrimoine et bien sûr bâtiments : le paysage de la Montagne magnifie partout la présence du granite.
|
|
|
De belles pentes offertes au regard, encore bigarrées par la présence de devèzes et de landes |
|
|
|
|
Le climat rude de la Montagne et les sols pauvres de rankers, où la matière organique peine à se décomposer, ne sont guère favorables à l'agriculture. La forêt couvre la majeure partie de la surface ; mais alors que le pin sylvestre domine sur le plateau à 1 000 m d'altitude, il se mêle ici aux hêtres, aux sapins et aux épicéas.
A la forêt s'ajoutent les sombres landes à callune, auxquelles s'ajoutent les landes à myrtille et celles à genêt (poilu, purgatif ou ailé). Elles conquièrent les devèzes, pacages entretenus par les grands troupeaux de transhumance, montés des plaines languedociennes, auxquels s'ajoutaient les bêtes appartenant aux habitants de la Montagne. Avec l'abandon des parcours, la conquête des devèzes par le genêt prépare celle de la forêt, qui se substitue progressivement aux landes.
Comme sur l'ensemble de la Margeride, la cueillette des produits offerts par les landes et les sous-bois contribue largement à l'économie locale : champignons, fleurs, myrtilles et autres petits fruits
|
|
|
Le lac de Charpal : petit éclat de Scandinavie en Margeride |
|
|
Dans la forêt domaniale de Charpal, étirée sur le plateau du Palais du Roi, le lac de Charpal offre un paysage de qualité, qui évoque la Scandinavie, grâce à ses rives douces aplanies et à la dominance de résineux à ses abords. Bien qu'il paraisse assez naturel, c'est un lac artificiel, obtenu par un barrage sur la Colagne.
A proximité des sources, les tourbières formées par l'accumulation de la matière organique non décomposée restent discrètes dans le paysage ; elles abritent une flore héritée des dernières périodes glaciaires : bouleau nain, saule des lapons, ligulaire de Sibérie, ...
|
|
|
Une agriculture concentrée sur l'élevage, dans les bas de pentes plus faciles à mécaniser |
|
|
|
|
Historiquement site d'estives dans le cadre de la transhumance, la Montagne de la Margeride s'est largement boisée au cours des dernières décennies, avec l'abandon des parcours sur les sommets : boisements artificiels, mais aussi conquêtes spontanées des pâtures par les landes à genêts ou bruyères. Aujourd'hui l'agriculture se concentre sur l'élevage des bovins à viande, occupant les terres basses et en replats les plus faciles à mécaniser : moins pentues, sans affleurement granitique. Les prairies de fauche produisent le foin nécessaire à l'alimentation des animaux durant le long hiver qui règne sur la Montagne. Elles permettent la préservation de nombreuses structures qui contribuent à dessiner et enrichir le paysage : arbres, murets, ...
Parmi les arbres, les frênes sont particulièrement représentés, leurs feuilles étant utilisées en complément de fourrage à la fin de l'été. En altitude, les saules, les bouleaux, occupent volontiers les fonds humides.
Sur la commune de Sainte-Eulalie, un parc à bisons s'est développé depuis 1991 sur 170 hectares : démarche scientifique d'élevages de bisons originaires du Parc National de Bialowiza en Pologne, à laquelle s'est ajoutée une exploitation touristique de découverte de ces grands herbivores. Les bisons de Sainte-Eulalie s'ajoutent aux loups de de Sainte-Lucie et aux vautours de la Jonte pour construire une image de grande nature sauvage et préservée propre à la Lozère.
|
|
|
Des villages rares, dans les fonds des vallons |
|
|
|
|
La Montagne est habitée, occupée par quelques villages. Tous sont tapis dans les fonds de vallées, occupant une place précise dans l'espace : en bas de pente, sur les marges des replats les plus favorables aux cultures, tournés vers le sud, à la jonction des fonds cultivables et des pentes autrefois parcourables par les troupeaux d'ovins.
|
|
|
|
|