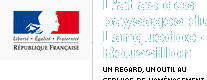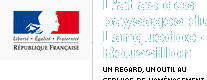|
|
|
> La Lozère
> La Margeride
> 6. Les plateaux et les vallées de la Margeride occidentale
> Valeurs paysagères clefs
|
6. Les plateaux et les vallées de la Margeride occidentale |
Valeurs paysagères clefs |
Une succession de doux mamelonnements cernant des fonds aplanis |
|
|
|
|
Le plateau de la Margeride se maintient autour de 1 000 m d'altitude sans être jamais plat. Il se présente comme une succession de collines aux formes arrondies, séparant des fonds aplanis qui, en certains endroits forment des petites dépressions en cuvettes et en d'autres des vallées généralement peu profondes et à fond plat. La plus marquée de ces vallées est la Truyère, qui prend une direction sud nord pour, en limite du département attaquer plus profondément les reliefs et former une entaille atypique dans le contexte margeridien.
|
|
|
Le granite, roche-mère omniprésente dans le paysage en Margeride |
|
|
Les formes arrondies en dômes des reliefs et les fonds plats trahissent la présence du granite. Cette roche magmatique vieille de plus de 300 millions d'années prend ces formes rondes à force d'être érodée. Les sables issus de cette érosion ou arènes, s'accumulent et nappent les fonds jusqu'à les aplanir régulièrement.
S'il n'est pas aussi marquant que dans la Montagne de la Margeride, le granite affleure néanmoins volontiers, trouant de ci -de là la toison des prairies de fauche, ou apparaissant sur les rebords érodés des vallées. Mais c'est surtout dans les constructions qu'il s'observe : habitations, fermes, petit patrimoine et même ...piquets de clôtures.
|
|
|
Des lisières douces et progressives entre bois et espaces ouverts, offertes par le pin sylvestre et le frêne |
|
|
|
|
La dominance du pin sylvestre, héritée de l'histoire du pâturage en Margeride et de sa propension naturelle à coloniser les espaces dégagés, permet encore aujourd'hui de constituer des lisières progressives entre espaces boisés et espaces ouverts. Ces lisières douces font de la Margeride non pas un pays de clairières fermées sur elles-mêmes, mais une terre encore majoritairement ouverte où les paysages boisés et agricoles s'enchaînent en un fondu enchaîné très original, qui fait une part de son caractère.
Quant aux sous-bois clairs des pins sylvestres, ils permettent la présence de myrtilles et de champignons, largement cueillis et constituant des revenus complémentaires non négligeables aux habitants.
Les frênes sont largement présents, notamment dans les vallées, en alignement ou isolés. Ils ont longtemps servi de fourrage d'appoint en fin d'été par émondage de leurs branches le long du tronc, ce qui explique leur forme en sucette souvent observée.
|
|
|
Des petites limagnes favorables au développement des bourgs |
|
|
|
|
Quelques anciennes petites vallées ont concentré des dépôts glaciaires et fluviaux jusqu'à être comblés et former de petites limagnes, plaines plus fertiles qui ont favorisé les implantations humaines : Saint-Alban-sur-Limagnole et le Malzieu-Ville.
|
|
|
La RN 9, la RN 106, la voie de chemin de fer et l'A75, des vecteurs de développement |
|
|
|
|
Entre les hauteurs du plateau de l'Aubrac à l'ouest et celle de la Montagne de la Margeride à l'est, le plateau margeridien, moins élevé, a naturellement été favorable au passage des infrastructures nord-sud.
Les deux principales routes traversant la Margeride, RN 9 et RN 106, ont favorisé le développement notamment là où des gares ferroviaires se sont ajoutées : Aumont-Aubrac et Saint-Chély-d'Apcher. L'aciérie implantée à Saint-Chély bénéficie même d'une desserte ferroviaire spécifique. Aujourd'hui ce faisceau est complété par l'A75, qui favorise le développement d'activités commerciales à ses abords.
|
|
|
Vallée de la Truyère et Cham de Chaulhac : quelques petits paysages particuliers aux franges nord de la Margeride |
|
|
|
|
Aux confins nord de la Margeride, des coulées volcaniques ont formé un petit plateau basaltique, la cham de Chaulhac, parfois appelée chan de Nozerolles. Son relief entièrement aplani en fait un site atypique en Margeride, et le basalte s'observe sur quelques maisons de Nozerolles et surtout de Chaulhac, en mélange avec le granite.
C'est dans le même secteur que la Truyère attaque plus vigoureusement le socle de la roche mère, profitant de la zone de contact entre granite et basalte. Quelques sites bâtis profitent de ce creusement de relief : le château de la Garde en ruine dans la vallée, le village d'Albaret-Sainte-Marie, mais aussi Pruniéras en amont du Malzieu-Ville.
|
|
|
Une architecture traditionnelle simple, marquée par le granite |
|
|
L'architecture traditionnelle est marquée essentiellement par le granite, et par des toits de lauzes et d'ardoise pentus (70 à 110°) adaptés à la présence de neige en hiver.
Les sites bâtis sont rarement en promontoire, plus souvent en contrebas des plus hauts sommets, sur le rebord des fonds de vallée avec une exposition sud-sud-est largement dominante.
|
|
|
Des matériaux d'architecture qui se mélangent au nord, en transition avec l'Auvergne |
|
|
|
|
L'architecture perd de sa belle unité vers le nord du département, où les matériaux hésitent et se mélangent entre granite, basalte, ardoise, lauze et schiste. Un mélange qui exprime le contact entre la Margeride granitique et l'Auvergne volcanique.
|
|
|
|
|