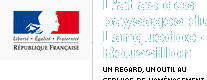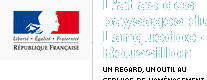|
|
|
> La Lozère
> Les Cévennes
> 25. Le mont Aigoual
> Valeurs paysagères clefs
|
25. Le mont Aigoual |
Valeurs paysagères clefs |
Un balcon spectaculaire sur le grand paysage, à caractère scientifique et touristique |
|
|
|
|
Le sommet du Mont Aigoual, limité en surface et bien identifiable dans le paysage, coiffé d'une station météorologique et accessible en voiture, fait l'objet depuis 100 ans d'une attirance qui en fait un des sites les plus touristiques des Cévennes. Pour ces raisons, il apparaît plus connu et plus fréquenté que le Mont Lozère, pourtant plus élevé.
C'est principalement pour bénéficier du large panorama qui s'ouvre à 360° que les visiteurs grimpent les pentes de l'Aigoual. La station météorologique a d'ailleurs créé un bélvédère sous forme de tour crénelée, représentative du goût du XIXe siècle pour le Moyen-Age...
La vue qui se dégage est en effet particulièrement large, atteignant Pyrénées, Alpes, chaîne des Puys et Méditerranée, par temps exceptionnellement clair.
Plus couramment :
- au sud s'étendent les collines des garrigues,
- à l'est s'allongent les serres schisteuses des Cévennes en vagues parallèles, qui s'arrêtent à l'amont sur les cans de Barre et de l'Hospitalet,
- au nord émerge le long dos du Mont Lozère, flanqué du mont Bougès, plus bas et plus sombre,
- au nord-ouest enfin les longues pentes de l'Aigoual s'arrêtent sur les remparts du causse Méjean.
La station météorologique qui trône au sommet de l'Aigoual a été inaugurée en 1894. Elle a été créée en accompagnement de la vaste entreprise de reboisement menée par Georges Fabre, pour étudier scientifiquement les facteurs climatiques intervenant dans la croissance des arbres introduits, comme cela se pratiquait déjà en Autriche.
Il faut dire que les conditions climatiques sont particulièrement rudes sur l'Aigoual : la montagne d'eau est bien nommée puisqu'elle reçoit chaque année 2 240 mm de précipitations, l'un des records de la France métropolitaine. Le vent s'ajoute à l'eau, quasi continuel, soufflant les deux tiers de l'année à plus de 50 km/h et parfois en tempêtes très violentes, à 250 km /h.
|
|
|
Des pentes complexes générant des paysages contrastés selon les versants |
|
|
|
|
L'Aigoual présente des versants hétérogènes. Grossièrement il s'apparente à un tremplin dont les pentes douces et irrégulières montent depuis le pied du causse Méjean et la vallée de la Jonte (côté atlantique) et dont les pentes raides plongent sur la vallée de l'Hérault vers le sud (côté méditerranéen). A l'est et à l'ouest, les reliefs de l'Aigoual prolongent les serres cévenoles : de la Vallée Borgne à l'est ; du Trévezel, de la Dourbie et de l'Arre, avec notamment la montagne du Lingas, à l'ouest.
Les pentes nord offrent de riches paysages, avec une morphologie complexe et chantournée dont les formes rondes et bombées sont caractéristiques de la nature granitique de la roche-mère. Elles sont largement couvertes par des landes à bruyères, à fougères et à genêts.
Les pentes raides de la vallée de l'Hérault sont majoritairement boisées de châtaigniers, sillonnées par les innombrables lacets de la RD 986.
|
|
|
De belles forêts largement dominantes, issues d'une remarquable politique de reboisement |
|
|
|
|
Les serres qui convergent sur l'Aigoual ont été durant des siècles empruntées par les troupeaux pour la transhumance, formant les drailles. Encore au XVIIIe siècle, un équilibre semble globalement se maintenir entre les forêts et les pâturages. Mais à la fin du siècle la pression sur les forêts pour les besoins des verreries, des fonderies et du chauffage s'accentuent ; dans le même temps les pâturages gagnent du terrain avec le grossissement des troupeaux, phénomène accentué au cours du XIXe siècle par les crises séricicoles de 1820 et 1853 qui contraignent les agriculteurs à développer l'élevage. Vers 1870, il ne reste que deux mille hectares de taillis de hêtres et de bois de pins sylvestres.
Sous le climat du Mont Aigoual, qui reçoit des abats d'eau extrêmement violents et abondants en automne, la mise à nu excessive des sols entraîne une érosion considérable et catastrophique. Les pluies entraînent tout : terres, roches et troncs et détruisent les routes, les villages, les moulins, les filatures des vallées vers Ganges, le Vigan et Valleraugue notamment. Les destructions les plus marquantes ont lieu en 1856, 1857, 1861, 1868.
A partir de 1875-1880, et pendant plus de cinquante ans, des millions d'arbres vont être plantés sur les pentes de l'Aigoual, sous l'impulsion et la direction d'André George Fabre : soixante huit millions de plants exactement. Avec Charles Flahaut, directeur de l'Institut de botanique de l'université de Montpellier, Fabre crée des arboretums expérimentaux sur une douzaine de sites dans l'Aigoual, afin de tester de novelles essences.
Dans les premiers temps on reboise en pins à crochets ou pins noirs d'Autriche, sans grande valeur. Mais ces espèces pionnières et frugales préparent les sols, produisent un peu d'humus et un couvert qui permet la plantation d'essences plus exigeantes, comme le sapin. On utilise aussi l'épicéa, le douglas, parfois le bouleau ; et le hêtre, présent naturellement, se maintient.
Grâce à cette ambitieuse entreprise d'aménagement qualitatif du territoire, une forêt diversifiée existe aujourd'hui, offrant de beaux paysages boisés, couvrant 15300 hectares, dont les deux tiers dans le Gard. Les hêtraies couvrent 3 300 ha, les peuplements mélangés de pins à crochets, épicéas et sapins : 6 500 ha ; les pins noirs, sylvestres et laricios : 2 000 ha.
|
|
|
Une place aujourd'hui précieuse pour les troupeaux |
|
|
Entre les débuts du XIXe siècle et du XXIe siècle, les proportions entre les forêts et les pâturages se sont inversées. Ce sont aujourd'hui les pâturages qui sont plus rares, occupant quelques sommets et formant des taches en vastes clairières dans les pentes. S'ajoutent aux pâturages les priairies de fauche et les landes à callunes et à genêts.
L'élevage sur l'Aigoual est aujourd'hui précieux, gérant les espaces ouverts, dégageant les vues et diversifiant les ambiances et les milieux.
|
|
|
Un secteur presque exempt de bâti |
|
|
Etant données les rudes conditions climatiques, le bâti reste quasiment absent du Mont Aigoual. Le hameau de Cabrillac, bâti en granite sur les pentes nord, profite d'un étroit replat entre les rivières naissantes de la Jonte et du Tapoul pour s'implanter. Situé sur la draille d'Aubrac (collectrice de la Luzette), le village accueillait bergers et promeneurs grâce à son auberge, qui existe toujours.
|
|
|
|
|