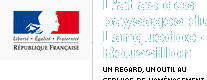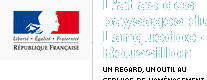|
|
|
> Le Gard
> Les Garrigues
> 35. La plaine urbanisée d'Alès
> Valeurs paysagères clefs
|
35. La plaine urbanisée d'Alès |
Valeurs paysagères clefs |
Alès, une ville aux portes des Cévennes. |
|
|
|
|
Alès constitue la principale ville-porte des Cévennes, développée au pied des pentes à la faveur du débouché du Gardon d'Alès dans la plaine. Autour du petit noyau central historique lové dans une boucle du Gardon, l'urbanisation apparaît aujourd'hui étonnamment diffusée dans la plaine, comme si le bâti avait besoin d'air et de place en contraste avec les contraintes topographiques sévères des vallées cévenoles adjacentes, qui ont conduit au tassement du bâti dans les fonds étroits des vallées. L'urbanisation s'étale ainsi sur plusieurs kilomètres à la ronde, vers Salindres au nord-est, Saint-Hilaire-de-Brethmas et Vézénobres au sud-est, Saint-Christol-lès-Alès et le Gardon d'Anduze au sud (communes de Boisset-et-Gaujac et de Ribaute-les-Tavernes). On mesure l'importance de la tache urbaine d'Alès en la comparant à celles d'Avignon et de Nîmes.
|
|
|
Un développement urbain qui a gagné les vallées mais aussi toute la plaine. |
|
|
|
|
L'urbanisation d'Alès s'est également développée sur le piémont Cévenol, et s'est avancée dans les vallées cévenoles, notamment dans celle du Gardon d'Alès vers la Grand-Combe, et dans celle de Saint-Jean-du-Pin (vallée du Lyonnais).
|
|
|
|
|
Ce développement important et relativement récent de l'urbanisation dans l'espace de la plaine et des pentes cévenoles ne peut s'expliquer qu'en rappelant l'histoire du développement industriel de la ville, l'extraction du charbon et du fer ayant longtemps fait d'Alès le premier centre d'industrie lourde de la moitié sud de la France. Démarrée de façon industrielle à la fin du XVIIIe siècle sous l'influence du sieur de Tuboeuf, l'exploitation des mines s'accélère au XIXe siècle avec la création de villes nouvelles comme Bessèges ou la Grand-Combe, reliées très tôt, dès 1840, à la vallée du Rhône par l'une des premières lignes de chemin de fer. La production se rationalise et se concentre, passant de 20 000 t en 1815 à 2 millions de tonnes en 1890. L'activité attire des montagnards du Massif Central, puis des immigrés espagnols, italiens, polonais et enfin nord-africains. Dans les années 1960, le centre ancien cède la place à un rempart d'immeubles-barres et de tours qui marque le paysage urbain du centre-ville aujourd'hui. A la même époque, la crise survient du fait de la concurrence grandissante des produits pétroliers et de l'énergie à bon marché. La demande en anthracite notamment, destinée surtout à l'usage domestique et principale production du bassin minier d'Alès, s'effondre. En trente ans, la crise, très dure, conduit à la fermeture totale des sites miniers.
|
|
|
|
|